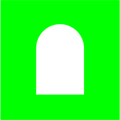En 2024 > Nicolas MULLER
En 2016 > Hugo Pernet – Natives
Située au milieu du cimetière, l’église de Boujeons est une petite église dont le clocher-porche, recouvert d’une talevanne de métal rouge, flamboie au soleil tandis qu’étincellent les tuiles vernissées de sa toiture à l’impériale. En grande partie reconstruite au XIXe siècle (le clocher en 1810 et la nef en 1843) elle n’a quasiment rien conservé de l’édifice primitif du XVIIe siècle.
Le clocher-porche ouvre sur une nef unique séparée du chœur liturgique par une travée d’avant-chœur. Le chœur est voûté en cul-de-four, l’avant-chœur est couvert par une voûte d’arêtes et la nef par un plafond. L’ensemble est éclairé par huit baies à vitrail : deux à motifs géométriques éclairent l’avant-chœur et parmi les six qui éclairent la nef, deux seulement représentent des personnages, l’une avec saint Joseph et l’autre avec la Vierge. Le décor est modeste et l’absence de mobilier donne à ce petit édifice une allure dépouillée. Ici pas de retable couvert de dorures, pas de colonnes torsadées ni de décor théâtral, pas de chaire à prêcher aux panneaux sculptés…, hormis quelques statues l’église est nue.
Parmi les statues il faut souligner la présence d’une Vierge à l’Enfant vraisemblablement du XVIIe siècle. Cette Vierge assise tenant un Enfant Jésus rieur sur ses genoux traduit plus l’image du bonheur de la jeune mère de famille avec son enfant que celle de la mère d’un enfant-dieu.
La Nativité de la Vierge, c’est le vocable de l’église, mais c’est aussi le sujet du tableau qui est aujourd’hui dans le chœur après avoir été au-dessus de la porte d’entrée. Il s’agit d’une œuvre sans doute de la fin du XVIIIe siècle inspirée des sources apocryphes que sont le Protévangile de Jacques et l’Évangile du pseudo-Matthieu.
GPS : 46,748778 / 6,204610